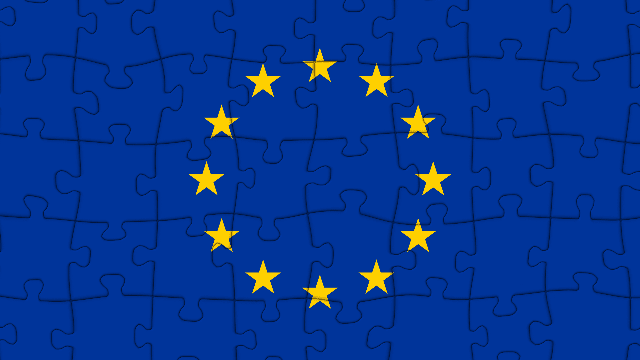Reflets Mag #156 | Géopolitique : L’UE doit rebattre ses cartes
Expansionnisme russe, désalignement des États-Unis, concurrence chinoise… Dans Reflets Mag #156, six experts ESSEC dressent un panorama des grands défis géopolitiques européens. Découvrez l’article en accès libre… et pour lire les prochains numéros, abonnez-vous !
Aurélien Colson (E98) : « L’UE affronte une conjonction de menaces »
Reflets Mag : À quelles menaces l’UE fait-elle face ?
A. Colson : D’une part la Russie mène une guerre de haute intensité contre un pays de notre voisinage, l’Ukraine, doublée d’une guerre hybride qui frappe directement nos intérêts : sabotage de câbles sous-marins d’énergie ou de télécommunications, brouillage de GPS à proximité d’aéroports baltes, cyberattaques contre nos hôpitaux, interférences avec les élections… D’autre part, la nouvelle administration américaine s’en prend à l’alliance euro-atlantique. Dans le même temps, jamais les partis anti-européens, d’extrême droite comme d’extrême gauche, n’ont été aussi puissants, soutenus (en sous-main) par la Russie et (ouvertement) par les trumpistes.
RM : Quels sont les scénarios pour l’avenir ?
A. Colson : Tout dépendra de la lucidité de nos dirigeants, de leur courage et de leur capacité à décider à 27. L’histoire récente donne un peu d’espoir : les États membres ont réussi à négocier dans l’urgence un plan de réponse massif à la pandémie puis des plans de sanctions successifs contre la Russie. Il faut le même volontarisme pour bâtir une dissuasion conventionnelle capable de tenir la Russie à distance malgré le retrait américain et reconquérir de la souveraineté économique.
RM : Quid d’un élargissement ? Plus d’union fait-elle plus de force ?
A. Colson : Pas moins de 10 pays sont candidats à l’entrée dans l’UE, et l’Arménie vient de faire un pas en ce sens. Pour autant, ces demandes heurtent tant les fédéralistes (pour qui chaque élargissement se fait au détriment des approfondissements) que les partisans de la coopération intergouvernementale (qui s’alarment de voir se multiplier les voix à la table du Conseil).
Frédéric Charillon, prof ESSEC : « La guerre en Ukraine sonne le glas des illusions européennes »
« La première illusion était celle d'un monde post-tragique, qui permettrait à l'Europe d’évoluer dans un environnement définitivement apaisé. On pensait le flanc Sud immuable, entre les mains de dirigeants autoritaires bien connus depuis des décennies, et le flanc Est inoffensif depuis la chute de l'Union soviétique. On n’a su anticiper ni les printemps arabes, ni la Géorgie puis l’Ukraine.
La deuxième illusion était celle d'une Europe puissante, capable de faire face à des imprévus stratégiques. Mais l'Europe a refusé d'abord de croire en la dangerosité de la Russie, puis d'augmenter significativement ses budgets militaires malgré les injonctions américaines. On a trop tardé à prendre la mesure de la gravité de la situation en Ukraine.
La troisième illusion était celle de la cohésion européenne. Si les États membres ont fait montre d'une certaine unité au début de la guerre en Ukraine, les dissidences se font de plus en plus profondes. En Hongrie ou en Slovaquie, on prend désormais parfois ouvertement le parti de Vladimir Poutine. Ce qui renverse la perception de l'élargissement aux anciennes républiques socialistes : on a cru à une victoire sur l'ancienne Union soviétique, on découvre que la présence de ces régimes au sein de nos institutions nous expose au risque d'un noyautage par Moscou.
Dernière illusion : celle d'une Amérique toujours présente pour protéger l'Europe. On n’a pas pu imaginer l'attitude actuelle de Donald Trump et d’Elon Musk. »
Nicolas Burnichon (M16) : « Le découplage avec la Russie semble irréversible »
RM : Quelles sanctions l’UE a-t-elle prises contre la Russie jusqu’ici ?
N. Burnichon : L’UE a adopté 15 paquets de sanctions depuis février 2022, auxquelles s’ajoutent celles prises après l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol en 2014. Ces mesures sans précédent incluent des restrictions individuelles (gel des avoirs, interdictions de territoire…) et sectorielles (limitation ou interdiction des financements et des échanges commerciaux dans certains domaines sensibles : énergie, militaire, finance, aéronautique, luxe…). Objectif : priver la Russie de toutes ressources extérieures contribuant directement ou indirectement à son effort de guerre.
RM : Quel est l’impact de ces sanctions ?
N. Burnichon : La Russie a perdu énormément de sources de revenus, notamment avec l’arrêt programmé des achats de pétrole et de gaz par la grande majorité des pays occidentaux, mais aussi avec le retrait de la quasi-totalité des entreprises européennes qui ont mis fin à leurs activités directes et indirectes sur place. Mais l’impact reste entamé par le contournement des mesures. Les derniers paquets de sanctions ont mis en place des mécanismes dédiés : obligations contractuelles, reporting, nouvelles désignations en dehors de Russie… Reste à renforcer la sensibilisation et la vigilance des parties prenantes. Et à réfléchir aux secteurs encore épargnés ou faisant l’objet de dérogations ou d’exemptions, car trop proches des intérêts européens.
RM : À l’inverse, à quelles conditions l’UE pourrait-elle lever ses sanctions ?
N. Burnichon : D’abord, la fin de la guerre ne signifiera pas forcément la fin des sanctions dans la mesure où certaines d’entre elles pourront être maintenues en gage de transition pérenne. Ensuite, le retrait prendra d’autant plus de temps qu’il nécessitera non seulement un consensus entre les États membres, mais aussi un certain alignement avec d’autres pays ou organisations. Enfin, le découplage de la Russie du système économique occidental, et son rapprochement parallèle avec l’Asie, semblent en partie irréversibles.
Cedomir Nestorovic, prof ESSEC : « Les divergences entre les USA et l’UE deviennent patentes »
« Joe Biden avait largement apaisé les relations transatlantiques : réaffirmation de l’engagement dans l’OTAN et auprès de l’Ukraine, coopération pour la relance économique post-Covid et pour la régulation des grandes entreprises technologiques… La réélection de Trump ravive les tensions. Comme promis durant sa campagne, il a retiré son pays de l'Accord de Paris sur le climat, annoncé une hausse significative des droits de douane au risque d’entraîner une guerre commerciale, et pris des positions qui préoccupent beaucoup face à la Russie et au Proche-Orient. Sur tous ces fronts, les divergences entre les États-Unis et l’UE deviennent patentes. »
Philippe Le Corre, prof ESSEC : « Il existe de nombreux irritants entre l’Europe et la Chine »
« Dès 2013, le régime de Xi Jinping annonce la couleur en déclarant : "L’Est s’est levé, et l’Occident est en déclin." Mais la vraie bascule s’opère en 2019 quand l’UE initie la stratégie dite du triptyque : la Chine est désormais qualifiée de "partenaire, concurrent économique et rival systémique". Le troisième terme en particulier marque un changement radical. De fait, il existe de nombreux irritants entre l’Europe et la Chine. D’une part sur le plan commercial : par exemple, Bruxelles a récemment imposé des taxes sur les véhicules électriques chinois auxquelles la Chine a répliqué avec ses propres sanctions, contre les alcools français notamment. D’autre part sur le plan géopolitique : soutien à Moscou, situation des droits de l’homme… Pour autant, nous n’avons pas abandonné l’espoir de travailler avec Pékin sur des questions comme le climat, la biodiversité ou la gouvernance de l’intelligence artificielle. En atteste le Sommet de l’IA à Paris, où le vice-Premier ministre chinois, Zhang Guoqing, a appelé à une collaboration mondiale pour protéger la sécurité et la recherche dans ce domaine, en adéquation avec la "communauté de destin" chère à Xi Jinping. Une pierre lancée dans le jardin des États-Unis et contre leur détermination à dominer le secteur. »
Jean-Marc Fenet, intervenant ESSEC : « Les Européens se méfient de plus en plus du libre-échange »
RM : Où en sont les négociations pour l’ALE entre l’UE et l’Inde ?
J.-M. Fenet : Difficile à dire. L’Inde multiplie certes les accords de ce type – avec les pays de l’AELE, l’Australie, les Émirats, et bientôt le Royaume-Uni. Mais elle continue de privilégier des dispositifs a minima, levant les barrières sur quelques secteurs choisis pour engranger des acquis rapides (early harvest). L’affaire est plus complexe avec l’UE, qui exige un contenu normatif et environnemental plus ambitieux et un champ d’application plus large, couvrant aussi les investissements et les indications géographiques en matière agricole. Par ailleurs, la coopération pâtit de torts historiques partagés : du côté européen, une vision trop exclusivement économique d’un pays qui n’est aujourd’hui encore que son 10e partenaire commercial ; du côté indien, une difficulté à appréhender la mécanique communautaire et une préférence manifeste pour l’approche bilatérale avec certains États membres. Résultat : lancées en 2006, les négociations ont été suspendues en 2013 pour reprendre en 2022, avant de s’interrompre à nouveau pendant les élections indiennes de 2024. Certains paramètres sont cependant susceptibles de faire bouger les lignes. Les tensions géopolitiques ont conduit l’UE à définir en 2021 une véritable stratégie indo-pacifique et à considérer l’Inde comme un partenaire incontournable dans la région. De son côté, l’Inde cherche à mieux s’insérer dans les flux économiques mondiaux et à se poser en alternative ou complément à la Chine (China plus one). Pour autant, l’atavisme protectionniste du pays reste solidement ancré et se voit conforté par le retour des tariffs partout dans le monde – pendant que les opinions européennes se montrent de plus en plus méfiantes vis-à-vis des ALE, comme l’illustre le cas du Mercosur.
RM : Pourquoi une telle hostilité au Mercosur ?
J.-M. Fenet : Faciliter les échanges avec quatre pays représentant 80 % du PIB sud-américain, rassembler 700 millions de consommateurs, enlever 90 % des droits de douane réciproques, ouvrir des débouchés importants pour l’industrie européenne (mécanique, transport, pharmacie), occuper un espace où la Chine est de plus en plus présente… Tout cela se plaide. Mais plusieurs points de friction subsistent. Sujet agricole, d’abord : même contingentée, l’entrée à taux réduit de viande bovine, de volaille et de sucre suscite la colère des exploitants européens, notamment français, sans que l’on entende les filières bénéficiaires de l’accord (vins, produits laitiers, indications géographiques). Sujet environnemental, ensuite, avec la difficulté à faire respecter les normes européennes et à mettre en place les fameuses « clauses miroirs » chez les producteurs. Sujet politique enfin : tout accord de libre-échange paraît désormais suspect aux yeux de pans entiers de la population européenne. En témoignent les critiques du CETA entre l’UE et le Canada, pourtant exemplaire dans les domaines évoqués.
RM : Dans ce contexte, quel avenir pour le Mercosur ?
J.-M. Fenet : Signé à la sauvette en décembre par la Commission, le texte doit passer au Conseil puis être ratifié. La tentation existe aujourd’hui à Bruxelles de le découper pour présenter les aspects purement commerciaux au seul Parlement européen et non dans chacun des 27… En parallèle, la France, réfractaire au projet en l’état, essaie de rassembler une minorité de blocage (au moins 4 pays représentant 35 % de la population de l’UE), avec possiblement la Pologne, les Pays-Bas, l’Italie ou l’Autriche. Rien n’est acquis pour autant, certains de ces États membres pouvant être tentés de monnayer des contreparties à leur appui.
Propos recueillis par Louis Armengaud Wurmser (E10), responsable des contenus ESSEC Alumni
Paru dans Reflets Mag #156. Voir le numéro exceptionnellement en accès libre. Recevoir les prochains numéros.
Image : © AdobeStock

Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés